Introduction
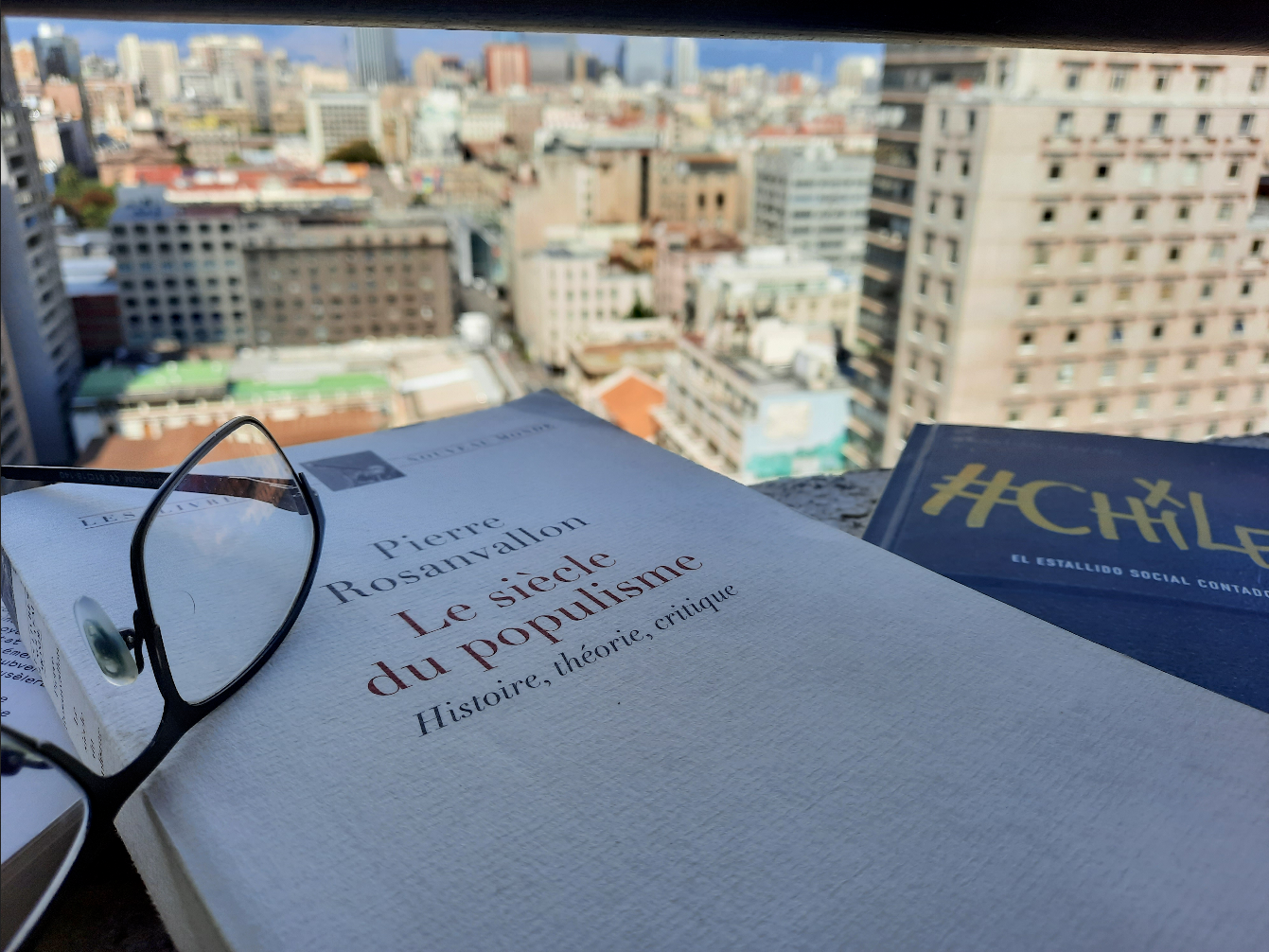
On ne présente plus Pierre Rosanvallon. Professeur au Collège de France, il est l’un des historiens et théoriciens du politique les plus prolifiques, avec une trentaine d’ouvrages à son actif, parmi lesquels La Crise de l’État-providence (1981), Le Sacre du citoyen (1992), La Contre-démocratie (2006) ou encore Le Bon gouvernement (2015)1. Dans son dernier livre, il se penche sur le phénomène populiste, dont il entend saisir l’essence. De fait, il ne s’agit pas d’en étayer les causes, par trop connues (crise de la représentation, brouillage du clivage droite-gauche, disparités socio-économiques), mais de comprendre ce qui fait sa spécificité ou sa nature. Les travaux académiques ont parfois tendance à ne voir dans le populisme que le symptôme d’une démocratie dysfonctionnelle ou à ne l’appréhender que comme un mouvement contestataire. Pour Rosanvallon, c’est oublier qu’il incarne aussi une « proposition politique, qui a sa cohérence et sa force positive » (2020, 12). Le paradoxe n’en reste pas moins que les protagonistes ou intellectuels post-marxistes qui s’en réclament n’ont pas, à de rares exceptions près (Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Pablo Iglesias ou Íñigo Errejón), contribué à sa théorisation2. À l’inverse, les grandes idéologies des XVIII, XIX et XXe siècles – telles que le libéralisme, le socialisme, le communisme, l’anarchisme ou le néo-libéralisme – s’arriment toutes à des doctrines philosophique, économique ou juridique et véhiculent des visions du monde spécifiques. Il est vrai qu’empiriquement le populisme répond plus à la passion – en l’espèce, la colère – qu’à la raison. Rosanvallon considère toutefois qu’en tant qu’il constitue « l’idéologie ascendante du XXIe siècle » (2020, 14), le populisme mérite qu’on lui consacre cet effort d’intellectualisation.
L’auteur procède en trois temps. La première partie décrit « l’anatomie du populisme » et en pointe les cinq éléments consubstantiels. Adoptant une perspective à la fois historique et géographique, la deuxième partie revient sur les « trois moments du populisme » et ses différents ancrages nationaux. La dernière, enfin, en dresse la critique, à l’aune des contradictions démocratiques que cette pratique du pouvoir fait naître. Notons qu’en sus d’une conclusion optimiste où il esquisse une solution alternative, le théoricien nous gratifie également, en annexe, d’une histoire du mot « populisme », dont il étaye en une vingtaine de pages les filiations russe (années 1870), nord-américaine (années 1890) et française (littérature des Années folles).
Les cinq éléments constitutifs du populisme
D’après Rosanvallon, le populisme c’est d’abord une certaine conception du peuple : « le peuple-Un » (2020, 27). Cette notion indique l’idée de cohésion presque physique, voire corporelle que la rhétorique populiste véhicule du public à laquelle elle s’adresse. En clair, le populisme entend traverser les clivages sociaux et transcender les classes. Il n’est plus question d’appeler à une lutte d’inspiration révolutionnaire, mais plutôt de justifier l’existence d’un antagonisme quasiment ontologique du peuple contre ses élites – tantôt ou indifféremment identifiées à « l’oligarchie », au « système », à « l’establishment » ou encore à la « caste ». La verve populiste développe ainsi une rhétorique schmittienne : les discours s’articulent toujours autour d’une dichotomie ami/ennemi renouvelée et qui s’exprime le plus souvent dans une vulgate réduite au « “eux” contre “nous” ».
Le populisme, c’est aussi une vision de la démocratie : « directe, polarisée, immédiate » (2020, 37). Les acteurs populistes font l’apologie de la démocratie directe et n’ont de cesse de vanter les mérites de leur instrument de consultation privilégié que représente le référendum, notamment « d’initiative populaire ». Du reste, ils cultivent une conception radicale (voire fascisante) du régime démocratique selon laquelle celui-ci est dominé par des instances juridiques (Cour constitutionnelle, magistrature, etc.) ou des organisations « contre-démocratiques » (agences indépendantes) – pour emprunter au vocabulaire de Rosanvallon (2006) – qui font ombrage à la volonté populaire. Comme n’ont pas hésité à le faire certains leaders en Hongrie, en Turquie ou encore au Venezuela, il convient donc de mettre ces organes au pas, afin de ne conserver que les attributs fonctionnels (ou instrumentaux) – en particulier le vote – et non plus substantiels (ou qualitatifs) de la démocratie. Quant à l’idée d’immédiateté, elle repose sur la valorisation – présente chez Carl Schmitt encore – de l’acclamation populaire comme expression d’un idéal démocratique pur, refusant la contradiction (voix discordantes) et s’affranchissant de toute forme d’encadrement ou de régulation (partis politiques, médias). À l’heure des nouvelles technologies, ce principe d’immédiateté qui vaut adhésion à un projet politique convertit le citoyen en simple « follower » du leader.
Dans la continuité de ce qui vient d’être étayé, le populisme se fonde sur une modalité spécifique de la représentation qui tient, selon Rosanvallon, de « l’homme-peuple » (2020, 47). Héritée des populismes latino-américains comme nous allons le voir, cette conception suggère une forme d’identification entre la masse et son chef. Celui-ci dit littéralement faire corps avec celle-là puisqu’il assure en être l’émanation directe. Citant l’entretien entre Chantal Mouffe et Íñigo Errejón (2017, 169), l’auteur rappelle que la figure du leader est indissociable du phénomène populiste :
Pour créer une volonté collective à partir de demandes hétérogènes, précise l’intellectuelle belge au politiste et cadre fondateur du mouvement Podemos en Espagne, il faut un personnage qui puisse représenter leur unité. Il ne peut donc pas y avoir de moment populiste sans leader.
De Trump à Mélenchon, une telle conception de la « représentation-incarnation » est au cœur de « la galaxie populiste » (2020, 53).
Sur le plan économique, le populisme défend un programme qui se réclame du « national-protectionnisme » (2020, 55). La plupart des acteurs populistes vont ainsi dénoncer les ravages de la mondialisation et prétendre, de manière optimiste ou fallacieuse, que la volonté politique conserve un pouvoir d’inflexion sur les dynamiques macro-économiques structurelles. Contempteurs des théories néolibérales, ils revendiquent la mise en place de mesures protectionnistes, visant à protéger les industries nationales et à lutter contre les délocalisations au nom d’un impératif de souveraineté populaire. Au plan social, leurs convictions se polarisent sur l’écart entre les nantis (les fameux « 1% ») et le reste (les « 99% » suivants), dont ils s’efforcent de séduire en particulier les plus pauvres et les plus déclassés d’entre eux. Au demeurant, leur conception de la justice et de l’égalité n’est pas toujours universelle. Pour les populistes de droite, les étrangers ou les minorités en sont exclus. D’après Rosanvallon, cet enjeu autour du sort qui doit être réservé aux immigrés et aux réfugiés constitue le clivage majeur entre les populismes de gauche et de droite. À ce propos, il écrit :
[…] cette question trace encore actuellement avec évidence une ligne de partage entre un populisme de droite ou d’extrême droite et un populisme de gauche. Le rejet de la “caste” va en effet de pair chez les premiers avec la dénonciation de la menace que feraient peser les immigrés sur l’identité du peuple, tandis que les seconds affirment un point de vue humaniste d’accueil. L’avenir politique du phénomène populiste est en grande partie lié aux conditions du maintien ou au contraire d’affaiblissement de cette distinction (2020, 92).
Enfin, le populisme relève d’un « régime de passions et d’émotions » (2020, 63). Et pour cause, les populistes entretiennent, en quelque sorte, un rapport affectif avec les individus qu’ils prétendent représenter. Le populisme consacre le « retour des émotions » en politique (2020, 64). D’après notre théoricien, ces affects sont de trois natures différentes. Les « émotions de position » (2020, pp. 68-69) trouvent leur origine dans la colère de ne pas être représenté et dans le sentiment d’abandon que vivent bon nombre d’électeurs. Elles traduisent un ressentiment latent à l’égard d’un système politique, social et économique perçu comme dysfonctionnel, car ne profitant prétendument qu’à une minorité au détriment d’une majorité. Les émotions dites « d’intellection » (2020, pp. 69-72) se fondent, quant à elles, sur la nécessité de rendre intelligible un monde devenu par trop complexe et étranger. Ces émotions ouvrent la voie aux dérives complotistes et à la diffusion de « vérités alternatives » (ou fake news). Comme le résume Rosanvallon (2020, 70) : « les sentiments d’opacité et d’impuissance publique que ressentent de nombreux citoyens s’inscrivent du même coup souvent dans des tentatives compensatrices de rationalisation imaginaire. Les visions conspirationnistes du monde correspondent en effet à une tentative de restaurer une cohérence dans un monde ressenti comme indéchiffrable et menaçant ». Quant aux « émotions d’intervention » (2020, pp. 72-74), elles puisent leur ressort dans la défiance et relèvent d’une « politique négative » (2020, 74). Cristallisées dans le fameux slogan argentin « Qu’ils s’en aillent tous ! » (¡Que se vayan todos!), elles appellent à une solution expéditive : le « dégagisme ».
Après avoir rappelé dans le sixième chapitre que le populisme contemporain est un mouvement diffus, polymorphe et capable d’ubiquité – car situé aux deux extrêmes du spectre politico-électoral, le théoricien entreprend, dans la seconde partie du livre, d’en dresser la sociogenèse.
Du césarisme français au laboratoire latino-américain
Si pour Rosanvallon « Napoléon fut le premier chef d’État de l’âge démocratique à se revendiquer d’une double légitimité : celle de la consécration par les urnes, mais aussi celle d’une certaine capacité d’incarnation » (2020, 157), la première véritable expression historique du populisme s’affirme à travers la pratique césariste du pouvoir telle que l’a exercée son neveu, Napoléon III. Le césarisme repose sur trois attributs ou conditions : 1) une valorisation du plébiscite vu comme expression directe de la souveraineté populaire, 2) une conception classique de la représentation selon laquelle le peuple tient tout entier en son chef – on peut penser ici au frontispice du Léviathan de Hobbes où les hommes s’agrègent dans la tunique du pouvoir – et, enfin 3) une crainte vis-à-vis du risque de dissolution sociale que feraient courir les corps intermédiaires, les partis politiques ou encore la presse. Cette hostilité s’est par exemple traduite par le rejet des scrutins de listes, l’interdiction des formations d’opposition ou la censure des publications3. Le césarisme est donc un type d’illibéralisme.
La deuxième séquence historique correspond aux deux décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale et qui auraient vu prévaloir, dans de nombreux cercles intellectuels et politiques réactionnaires, l’idée d’une décrépitude morale généralisée4. Sur fond de montée en puissance de la mondialisation industrielle et financière, cette période correspond à l’acmé des nationalismes et à la recrudescence des tensions internationales. Alors que la France vient de connaître l’épisode boulangiste et se divise sur l’affaire Dreyfus, les États-Unis voient naître l’éphémère Parti du peuple (People’s Party), qui prospère sur la critique du « système des dépouilles » et dénonce avec virulence le fonctionnement clientéliste auquel se livrent les deux partis traditionnels, notamment au niveau local. Surtout implanté dans les régions rurales du Midwest, le Parti du peuple sera bientôt supplanté par le Mouvement progressiste (Progressive Movement), lequel contribue à inscrire à l’agenda politique plusieurs réformes institutionnelles telles que la création des primaires, l’autorisation des référendums d’initiative populaire, le droit de vote pour les femmes ou la mise en place de mécanismes de révocation des élus. Dans le même temps dans les États du Sud, les Lois Jim Crow établissent le système ségrégationniste. À l’instar de l’Europe où la xénophobie et l’antisémitisme ont le vent en poupe, le populisme verse également, en Amérique du Nord, dans le racisme.
En Amérique latine en revanche, le populisme acquiert une tonalité résolument anti-élitiste. À l’instar d’un Jorge Eliécer Gaitán en Colombie présenté comme le « tribun du peuple », Juan Perón en Argentine, Getúlio Vargas au Brésil ou Lázaro Cárdenas au Mexique se font les porte-voix des masses populaires qui viennent « d’entrer en politique » à la faveur de l’extension du suffrage. Rosanvallon rappelle la fascination que le fascisme italien a exercée sur la plupart de ces leaders et que l’on pourrait retrouver dans les visions dirigistes et corporatives qui ont structuré leurs projets de société. L’auteur laisse entendre que les programmes des populistes latino-américains ne s’embarrassaient pas de contradictions : même si l’oligarchie était attaquée dans les discours, les modes de production n’ont guère été fondamentalement remis en cause. Or, cette interprétation est sujette à caution, dès lors qu’il est communément admis que le modèle d’industrialisation par substitution d’importation (dit « ISI ») a précisément connu son envol « au temps du populisme (1930-1950) »5. Il n’empêche, la conclusion de Rosanvallon sur ce « troisième moment populiste » n’en demeure pas moins très éclairante : le populisme latino-américain ne saurait être appréhendé comme un simple phénomène de transition supposément liée à un archaïsme préindustriel et défendant un réformisme équivoque ou une troisième voie entre communisme soviétique et capitalisme américain. En un sens, son tréfonds « démocratique » (inclusion des masses) et « contre-révolutionnaire » (abolition des classes) a quelque chose de précurseur.
Pour une critique constructive du populisme
Dans la troisième partie de l’ouvrage, l’intellectuel échafaude une analyse critique, pointant les incidences potentielles du phénomène populiste sur la démocratie, ses principes et ses instruments. Il débute sa réflexion par la « question du référendum » (2020, 173). D’après Rosanvallon, l’usage qu’en font (ou entendent en faire) les populistes soulèvent quatre apories. En premier lieu, le référendum dilue la responsabilité politique qui est pourtant, comme l’a souligné Christian Bidégaray (2000), au fondement même de la démocratie. En effet, en tant que source du pouvoir constituant originaire (Schmitt 1993, pp. 212-216), le peuple est « irresponsable, puisqu’il est la puissance créatrice d’un ordre politique donné » (2020, 177). Ainsi que le précise notre théoricien, « ses décisions sont sans appel, puisqu’il n’y a rien au dessus de lui » (2020, 177)6. Eu égard à ce postulat ontologique, un usage abusif du référendum le priverait non seulement de son essence première – qui est de créer l’ordre politique, mais rendrait surtout paradoxalement le peuple impuissant. Car, sur l’exemple du Brexit dont nombre d’électeurs ont jugé a posteriori qu’ils avaient été trompés, il n’y a guère plus de possibilités de faire machine arrière et de demander des comptes aux acteurs responsables de ce dévoiement populaire. Dans un tel contexte d’adversité politique, le risque est une fois de plus de faire le lit de l’autoritarisme. De surcroît, le recours au référendum entretient la confusion entre la volonté et la décision politiques : la première s’élabore sur le temps long ; la seconde est l’expression d’une immédiateté. Or, gommer la distinction entre les deux, c’est prendre le risque de fragiliser l’idée même de consensus politique et de ne voir dans le référendum, en l’absence de procédure de révocation (mandat représentatif et non impératif), qu’un moyen négatif de purger la défiance citoyenne à l’égard des élus. En clair, avant d’être le résultat d’un choix informé sur l’objet du débat, répondre « non » à la question posée peut être l’expression d’une critique contre le gouvernement, voire celle d’une véritable aversion vis-à-vis de l’ensemble de la classe politique. Dans la continuité de cet argument, le référendum écarte la délibération du jeu politique, et en réduit les règles à une option binaire qu’incarnent deux camps présentés comme irréconciliables. La démocratie se polarise et la figure du citoyen modéré se voit peu à peu supplantée par celle, en quelque sorte, de l’électeur censeur. Enfin, le référendum dans son acception populiste absolutise le fait majoritaire, tout en réduisant la portée du pouvoir législatif. D’une part, il sacralise la volonté générale au détriment des opinions minoritaires. D’autre part, il renforce la tendance à la présidentialisation des régimes démocratiques.
Par ailleurs, « en dénonçant le caractère non démocratique des autorités indépendantes et des cours constitutionnelles en tant qu’institutions qui ne sont pas validées par le suffrage universel, la vision populiste de la démocratie conduit paradoxalement à une forme d’absolutisation de la légitimation par les urnes » (2020, 197). Ce que reproche ici Rosanvallon au fait populiste, c’est d’oublier que la démocratie est bien autre chose qu’une simple opération arithmétique de recueil de votes, qui se ferait à intervalle régulier et en fonction d’un calendrier électoral prédéfini. L’onction populaire qui consacre les élu.e.s ayant recruté la majorité des suffrages ne leur accorde finalement qu’un statut – celui de représentant.e.s de la Nation. Du reste, la qualité d’une démocratie ne repose pas que sur la conformité des élections – qui se doivent d’être justes, libres et compétitives –, mais aussi sur la vitalité des organisations indépendantes (cours constitutionnelles, agences, commissions parlementaires, etc.) qui participent à l’évaluation de la gestion gouvernementale et au contrôle de l’action publique. Leur rôle ne saurait être minimisé, sans quoi le principe même de séparation et d’équilibre des pouvoirs s’en trouverait affecté. Or, en niant leur légitimité au motif qu’il s’agit prétendument d’institutions « non-élues », les populistes dévoilent, en réalité, moins leurs convictions démocratiques que leurs tendances autoritaires7.
À ce propos, après avoir critiqué la lecture manichéenne, simplificatrice et caricaturale que le populisme donne du social – la société est traversée par des tensions qui ne se réduisent pas à l’opposition entre le peuple et ses élites, Rosanvallon conclut sa réflexion sur les risques de « démocratures » que font courir les populistes. Mus par un désir contradictoire de changement radical autant que de permanence, ils véhiculent une vision d’irréversibilité de la politique. Les constitutions nationales doivent être remodelées selon leurs principes et leurs mandats, prorogeables de manière indéfinie. Quand ils ne les dévitalisent pas ou ne les brutalisent purement et simplement, ils font en sorte de soumettre les institutions publiques à leur férule ou de les coopter ; tant et si bien que l’on peut évoquer une « privatisation de l’État, vidant de sa substance la notion même de service public » (2020, 236). Peu enclins à accepter la défaite électorale, ils n’ont enfin que mépris pour leurs adversaires politiques. La conclusion de cette troisième partie est à la fois sans appel et d’une sagacité éclairante :
[…] c’est dans la prétention à incarner le bien public que se drapent les régimes populistes pour justifier leurs actions et leur rapport distancié à l’État de droit, dissolvant par là-même ce qui fait l’essence de la démocratie comme type de communauté politique ouverte et pluraliste (2020, 241).
Conclusion : vers une nouvelle approche épistémologique
Parce qu’il renouvelle les travaux sur le populisme, ce livre fera, sans nul doute, date. Notons que sa sortie en librairie a été précédée de quelques semaines par celle de l’ouvrage de Federico Tarragoni (2019) qui, lui aussi, s’est lancé comme défi de porter un regard sociologique sur ce phénomène politique inextricable, dont la définition faussement consensuelle désignerait, selon ses amis et collègues, « un ‘‘truc’’ d’extrême droite », susceptible « de transiter à la gauche de la gauche », tournant « autour du mécontentement populaire » et traduisant « une défiance systémique envers l’establishment » (Tarragoni 2019, 12)8. In fine, ces deux ouvrages inaugurent un nouveau champ d’investigation qui prend le populisme « au sérieux », sans préjugés négatifs, ni arrière-pensées normatives. Dans leurs conclusions respectives, alors que Tarragoni (2019, pp. 357-362) n’en défend pas moins un populisme « plébéien, cosmopolitique et anti-souverainiste », Rosanvallon s’en tient à une simple « alternative » (2020, pp. 245-252).
Pour remédier à la crise de la représentation, l’auteur se prononce pour la mise en place de dispositifs permanents de consultation, de cogestion et de reddition de comptes. En revalorisant ainsi le caractère « interactif » de la démocratie, il prétend que se renforceront les liens entre gouvernants et gouvernés. De surcroît, pour bâtir ce rapport renouvelé au politique, il faut adjoindre à la relation classique « représentation-délégation » une nouvelle conception qui relève d’une « représentation narrative » (2020, 248). Car il n’est rien de plus cruel pour un individu et a fortiori de plus amer pour un citoyen en régime démocratique que de se sentir invisible et mal représenté par ses élus. Par-delà le vote qui signifie « la délivrance électorale d’un permis de gouverner », une démocratie se bâtit à partir d’un rapport de confiance (voire d’identification) avec ses représentants (2020, 250). En clair et sans que l’auteur l’affirme explicitement, il semble nécessaire que les élus soient désormais plus proches socialement et sociologiquement de leurs administrés. La représentation nationale devrait être à l’image de la diversité d’une société ; ce qui implique de faire une place plus importante aux jeunes, aux professionnels peu qualifiés, aux femmes ou encore aux minorités.
Bibliographie
Anceau, Éric. 2008. Napoléon III : un Saint-Simon à cheval. Paris: Tallandier.
Bidégaray, Christian. 2000. « Le principe de responsabilité fondement de la démocratie. Petite promenade dans les allées du “jardin des délices démocratiques” ». Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, nᵒ 92 (janvier):5‑16. https://revue-pouvoirs.fr/Le-principe-de-responsabilite.html.
Clemenceau, Benjamin. 2020. « Federico Tarragoni, L’esprit démocratique du populisme. Une nouvelle analyse sociologique ». Lectures. https://doi.org/10.4000/lectures.41492.
Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine. 9e édition. Colin U. Armand Colin.
Deleixhe, Martin. 2020. « L’ambivalence du populisme ». La Vie des idées. https://laviedesidees.fr/Tarragoni-esprit-democratique-populisme.html.
Larrouqué, Damien. 2020. « Menace sur la démocratie ». La Vie des idées. https://laviedesidees.fr/Levitsky-Ziblatt-democracies-Crown-mort-democraties.html.
Levitsky, Steven, et Daniel Ziblatt. 2018. How Democracies Die. New York: Crown.
Mouffe, Chantal, et Íñigo Errejón. 2017. Construire un peuple : Pour une radicalisation de la démocratie. Idées. Paris: Éditions du Cerf.
Noyé, Sophie. 2018. « Chantal Mouffe, Íñigo Errejón, Construire un peuple : Pour une radicalisation de la démocratie, Éditions du Cerf, 2017, 256 pages ». Raisons politiques 71 (3):181‑86. https://doi.org/10.3917/rai.071.0181.
Premat, Christophe. 2005. « Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours ». Sens public. http://sens-public.org/articles/112/.
Rosanvallon, Pierre. 2006. La Contre-Démocratie : La politique à l’âge de la défiance. Sciences humaines. Paris: Seuil.
Rosanvallon, Pierre. 2020. Le Siècle du populisme : Histoire, théorie, critique. Les Livres du nouveau monde. Paris: Seuil.
Schmitt, Carl. 1993. Théorie de la Constitution. Quadrige. Paris: PUF.
Tarragoni, Federico. 2019. L’esprit démocratique du populisme. L’horizon des possibles. Paris: La Découverte.
Winock, Michel. 2017. Décadence fin de siècle. L’esprit de la cité. Paris: Gallimard.
Signalons que Christophe Premat a réalisé pour Sens Public la recension (2005) du titre suivant : Le Modèle politique français (Paris, Seuil, 2004). De même, nous renvoyons à l’entretien réalisé par Gérard Wormser en 2008 à l’École normale supérieure de Lyon, portant sur Les Métamorphoses de la légitimité (Canal TV).↩
Voir notamment le livre d’entretien entre Chantal Mouffe et Íñigo Errejón (2017) et la recension que lui a consacrée Sophie Noyé (2018) pour Raisons politiques.↩
Remarquons toutefois que le régime impérial a soutenu l’essor des coopératives et des mutuelles dans les années 1860 et même concédé le droit de grève en 1864. Favorable au libre-échange, Napoléon III n’en était pas pour autant un partisan du laissez-faire. Il apparaîtrait, au contraire, comme saint-simonien en pratique – c’est-à-dire, dirigiste – ou, tout du moins, assez perméable aux théories socialistes qui aspirent à l’abolition des classes plutôt qu’à leur exacerbation révolutionnaire (marxisme). Pour plus de renseignements, voir Éric Anceau (2008).↩
Sur ce sujet, voir l’excellent ouvrage de Michel Winock (2017).↩
Pour plus de renseignements, voir Olivier Dabène (2020, pp. 73-106).↩
Notons que c’est précisément au nom de ce principe que le Conseil constitutionnel se refuse, depuis sa fameuse décision du 6 novembre 1962 (rendue dans le cadre du conflit politique entre le Parlement et le Général de Gaulle concernant l’élection au suffrage universel direct du Président), à juger de la constitutionnalité des lois référendaires.↩
Pour aller plus loin dans ces réflexions, voir l’excellent ouvrage de Steven Levitsky et Daniel Ziblatt (2018), dont j’ai eu le plaisir de rédiger la recension pour La Vie des Idées (Larrouqué 2020).↩
Voir les recensions écrites sur cet ouvrage par Benjamin Clemenceau (2020) pour Lectures et Martin Deleixhe (2020) pour La Vie des idées.↩
